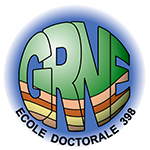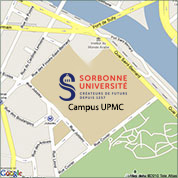Un nouveau modèle topographique du paléo-canyon du Rhône pour mieux évaluer l’aléa sismique de la région

La région de la moyenne vallée du Rhône possède de nombreuses installations énergétiques pour lesquelles il est important d’avoir une bonne estimation de l’aléa sismique. Or, la région est marquée par la présence d’un profond canyon creusé par le Rhône lors de la Crise de Salinité Messinienne, dont l’architecture et le remplissage sédimentaire sont encore mal contraints. Une nouvelle étude menée par l’ISTeP et en collaboration avec l’ASNR (ex-IRSN), s’est donc attelée à mieux caractériser ce canyon par l’analyse de données sismiques.
Il y a environ 6 millions d’années, le bassin méditerranéen a connu une crise environnementale majeure. À la suite de mouvements tectoniques au niveau du détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée s’est en effet retrouvée isolée de l’océan Atlantique. Le bilan hydrologique étant alors négatif, le niveau de la mer s’est mis à baisser de façon dramatique. Cet épisode qui a duré moins de 600 000 ans et qui a conduit à la formation d’énormes dépôts évaporitiques est connu sous le nom de Crise de Salinité Messinienne.
De profonds canyons creusés lors de la Crise de Salinité Messinienne
En réponse à cette importante baisse de niveau marin, les fleuves se jetant dans la mer ont incisé de profonds canyons, qui marquent encore le paysage aujourd’hui, comme les gorges du Verdon, ou la vallée du Rhône. Ils ont cependant été comblés de sédiments à partir de la fin de la Crise de Salinité Messinienne, qui a été marquée par une remise en eau rapide du bassin méditerranéen.
La morphologie et l’architecture de ces anciens canyons restent cependant mal contraintes. Or, la moyenne vallée du Rhône abrite actuellement de nombreuses industries à risque (usines chimiques, barrages hydroélectriques, centrales nucléaires…). On sait, par les études paléosismologiques, que la région est potentiellement active d’un point de vue sismique. Une connaissance détaillée du sous-sol, et notamment de la nature et de l’architecture du remplissage sédimentaire, est donc essentielle pour évaluer correctement le risque sismique. La présence de sédiments mous dans la vallée du Rhône aurait d’ailleurs joué un rôle d’amplificateur lors du séisme du Teil (on parle d’effet de site), en 2019. Ce séisme inattendu avait causé des dégâts significatifs non loin d’installations nucléaires.
À gauche, les données utilisées pour la construction des modèles topographiques, à droite le modèle topographique pour le canyon messinien du paléo-Rhône © Do Couto et al. 2024, Bulletin de la Société Géologique de France
Le tracé des paléo-rivières et leur topographie révisés
Une équipe de chercheurs menée par Damien Do Couto (ISTeP, Sorbonne Université) a donc conduit une étude visant à produire une reconstruction 3D de la morphologie du canyon messinien du paléo-Rhône. En se basant sur l’analyse de cartes géologiques, de modèles numériques de terrain et de données de subsurface (profils sismiques et forages), les chercheurs ont pu considérablement préciser nos connaissances sur la façon dont le canyon a été creusé puis rempli, en regard des différentes étapes de la Crise de Salinité Messinienne. Les données ont également permis d’identifier les potentielles failles actives pouvant affecter les sédiments du canyon, permettant ainsi de mieux caractériser le risque sismique de la région. Les résultats ont été publiés dans la revue Earth Science Bulletin du BSGF. Ils révèlent le tracé des paléo-rivières en proposant des modifications significatives par rapports aux études antérieures. Au niveau du Tricastin, le canyon du paléo-Rhône apparait ainsi plus profond que ce qui était proposé jusqu’à présent, avec une profondeur allant jusqu’à 700 mètres sous le niveau de la mer ! Le cours et la profondeur de l’Ardèche ont également été révisés. Plusieurs failles identifiées montrent une activité récente. Ces données devraient permettre de mieux évaluer l’aléa sismique de la région, notamment via une meilleure caractérisation des effets de site.
Brève rédigée par Morgane Gillard
Pour en savoir plus : Damien Do Couto, Edward Marc Cushing, Ludovic Mocochain, Jean-Loup Rubino, Florian Miquelis, Franck Hanot, Bérénice Froment, Céline Gélis, Hubert Camus, Nanaba Bagayoko, Olivier Bellier; Messinian canyons morphology of the Rhône and Ardèche rivers (south-east France): new insights from seismic profiles. Bulletin de la Société Géologique de France 2024;; 195 (1): 19.
doi: https://doi.org/10.1051/bsgf/2024015
Image de couverture : Site nucléaire du Tricastin située dans la vallée du Rhône © Michiel1972, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Egalement dans la rubrique
- Brève n°2 - Des grains de pollen pour reconstruire l’histoire des mangroves
- Brève n° 6 - Dater les plissements tectoniques à l’aide des veines et des failles qui affectent les couches
- Brève n°33 - De la matière organique continentale enfouie au fond des océans !
- Brève n°34 - Les vers de terre ont un rôle essentiel dans la minéralisation du carbone organique
- Breve n°35-Le volcanisme de Mayotte ne serait pas lié à un point chaud
- Brève n°36 - Première image interne du nouveau volcan sous-marin, Fani Maoré, au large de Mayotte
- Brève n°37 - Volcanisme et tectonique découverts le long de l’archipel des Comores entre l’Afrique et Madagascar : Une limite de plaque en développement.
- Brève-n°38 - Au cœur de la structure des plagioclases : révision du formalisme thermodynamique permettant de modéliser le comportement de ces minéraux
- Brève n°39 - Des grains de pollen pour comprendre l’adaptation des arbres durant les dernières glaciations
- Brève n°40 - Déterminer la durée de la phase pré-éruptive d’un volcan grâce à l’analyse des roches volcaniques
- Brève N°23-01 - Expliquer la morphologie et le relief de la côte iranienne du Makran
- Brève_n°23-02
- Brève_n°23-03
- Brève_n°23-04
- Brève_n°23-05
- Brève_n°23-06
- Brève_n°23-07
- Brève_n°23-09
- Brève_n°23-10
- Brève_n°23-11
- Brève_n°23-13
- Brève_n°23-14
- Brève_n°23-15
- Brève_n°23-16
- Brève_n°23-17
- Brève_n°23-18
- Brève_n°23-19
- Brève_n°23-21
- Brève_n°23-22
- Brève_n°23-23
- Brève n°23-24
- Brève-n°23-25
- Brève_n°23-26
- Brève_n°23-28
- Brève_n°23-29
- Brève_n°23-30
- Brève_n°23-31
- Brève_n°23-32 - Plongée dans l’histoire tectonique fascinante des Caraïbes
- Brève_n°23-34
- Brève_n°23-35
- Brève_n°23-36 - Autopsie d’une dorsale ultra-lente : les processus d’exhumation disséqués
- Brève_n°23-37&38
- Brève n°25-2
- Brève_n°25-3
- Brève_n°25-4
- Brève_n°25-07
Chiffres clés (Mars 2025)
L'ISTeP comprend 131 membres dont :
Permanents (66)
- Professeurs : 17 (+2 PAST)
- Maîtres de conférence : 26
- Directeurs de recherche CNRS : 1
- Chargés de recherche CNRS : 1
- ITA : 19
Personnels non permanents (65)
- Collaborateurs bénévoles / émérites : 17
- Chaire de professeur junior : 1
- Enseignants-chercheurs contractuel : 2
- 1 MCF accueil en délégation
- ATER et Post-Docs : 9
- Doctorants : 32
- ITA-BIATSS : 3