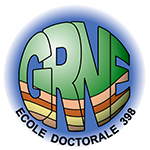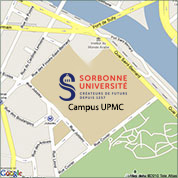Détection et quantification de microplastiques dans les sédiments : vers une méthode fiable avec le Rock-Eval®

La pollution par les microplastiques est devenue l’un des enjeux environnementaux majeurs du XXIème siècle. Depuis les années 1950, la production mondiale de plastique est en effet passée de 2 à 450 millions de tonnes par an, entraînant une accumulation croissante de fragments plastiques dans les écosystèmes aquatiques, notamment dans les sédiments fluviaux, lacustres et marins. Identifier et quantifier ces particules est essentiel pour comprendre leur devenir et leurs impacts, mais les méthodes classiques (µFTIR, Py-GC/MS) sont complexes, coûteuses, et nécessitent des traitements d’échantillons qui peuvent induire des biais, notamment lors de la séparation des microplastiques de la matrice minérale.
Tester la pertinence du Rock-Eval® pour détecter et quantifier les microplastiques dans les sédiments
Dans ce contexte, une nouvelle étude menée par Clémentine Ricard (ISTeP) et collaborateurs explore la pertinence duRock-Eval® comme outil alternatif et simplifié pour détecter et quantifier les microplastiques dans les sédiments. La méthode Rock-Eval® repose sur une pyrolyse puis une oxydation programmée des échantillons, permettant de mesurer la libération d’hydrocarbures, de CO et de CO₂, ainsi que plusieurs paramètres comme le Total HC (quantité totale d’hydrocarbures émise) et le Tpeak (température de libération maximale des hydrocarbures), qui s’avèrent être caractéristiques de chaque polymère plastique.
L’étude, publiée dans la revue Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, visait à déterminer comment les matrices minérales (argiles, quartz, calcite, goethite…) influencent la dégradation thermique de différents polymères courants (Polyéthylène - PE, Polyéthylène téréphtalate - PET, Acide polylactique - PLA). Pour cela, des mélanges synthétiques de polymères et de minéraux ont été analysés au Rock-Eval®, sans séparation préalable des microplastiques, une approche qui contraste avec les protocoles exigeant des méthodes classiques.
Modèle conceptuel des effets produits par les matrices minérales sur la dégradation thermique des polymères © Ricard et al. 2025
Une approche fiable
Trois effets majeurs des matrices sur la dégradation thermique des polymères ont été identifiés :
-
Effet catalytique : certaines matrices comme les argiles et la goethite accélèrent la décomposition de certains polymères, abaissant ainsi le Tpeak. C’est le cas pour le PE et le PLA, dont la dégradation thermique est facilitée par les sites actifs de ces minéraux. Ce phénomène reflète une interaction directe entre la structure de la matrice et le polymère.
-
Effet de désorption thermique : observé surtout pour le PET et certains mélanges à base de PLA, il se manifeste par la libération des hydrocarbures en plusieurs étapes (multimodalité). Cette désorption retardée suggère que des interactions chimiques complexes ont lieu entre les produits de dégradation des polymères et les surfaces minérales, nécessitant des températures plus élevées pour achever la libération des hydrocarbures. L’effet est marqué pour la calcite, les argiles, et la goethite.
-
Effet de rétention : les matrices peuvent retenir les produits de dégradation des polymères, réduisant ainsi le Total HC mesuré. Cet effet a été observé pour tous les polymères, notamment en présence d’argiles ou de goethite, suggérant un mécanisme d’adsorption des produits de la dégradation sur la surface de la matrice.
Malgré ces effets, des relations linéaires robustes entre la concentration en polymère et le Total HC ont été obtenues, confirmant la fiabilité quantitative de la méthode, même pour des matrices complexes. Les tests sur des matrices naturelles ont révélé des comportements similaires à ceux des matrices synthétiques, à condition que le taux de carbone organique total (TOC) de la matrice soit faible ou nul. En présence de matière organique, les effets de matrice semblent s’atténuer.
Des points à éclaircir avant une application sur des échantillons naturels
L’étude recommande cependant de poursuivre les recherches sur deux aspects clés :
-
Les effets de co-pyrolyse : dans les environnements naturels, les plastiques sont rarement monospécifiques. Des mélanges de polymères peuvent interagir pendant la dégradation thermique, modifiant les profils de libération d’hydrocarbures.
-
La différenciation des polymères à Tpeak proches : certains textiles synthétiques (ex. PET, viscose, nylon) présentent des pics thermiques très proches, rendant leur distinction difficile avec le Rock-Eval® seul.
Mélange entre un polymère (PE) et une matrice (illite) observé au MEB en cours de pyrolyse à 220° © Téa Popisailovic, Clémentine Ricard, François Baudin
En révélant les effets complexes mais interprétables des matrices minérales sur la pyrolyse des polymères, cette étude pose les bases d’un protocole thermique simple, fiable et adaptable pour la détection et la quantification des microplastiques dans les sédiments. Le Rock-Eval® peut être envisagé comme une méthode prometteuse pour les analyses de pollution plastique dans des contextes variés (milieux marins, lacustres ou continentaux), sans recourir à des étapes de traitement lourdes ou coûteuses.
Brève rédigée par Morgane Gillard
Pour en savoir plus : Clémentine Ricard, François Baudin, Maria-Fernanda Romero-Sarmiento, Nicolas Bouton, Yoann Copard, Lucas Friceau, Victor Lieunard, Wolfgang Ludwig, Sébastien Rohais, The effect of the mineral matrix during thermal analysis of polymers: Implications for microplastics characterization, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 191, 2025, 107219, ISSN 0165-2370, https://doi.org/10.1016/j.jaap.2025.107219.
Egalement dans la rubrique
- Brève n°2 - Des grains de pollen pour reconstruire l’histoire des mangroves
- Brève n° 6 - Dater les plissements tectoniques à l’aide des veines et des failles qui affectent les couches
- Brève n°33 - De la matière organique continentale enfouie au fond des océans !
- Brève n°34 - Les vers de terre ont un rôle essentiel dans la minéralisation du carbone organique
- Breve n°35-Le volcanisme de Mayotte ne serait pas lié à un point chaud
- Brève n°36 - Première image interne du nouveau volcan sous-marin, Fani Maoré, au large de Mayotte
- Brève n°37 - Volcanisme et tectonique découverts le long de l’archipel des Comores entre l’Afrique et Madagascar : Une limite de plaque en développement.
- Brève-n°38 - Au cœur de la structure des plagioclases : révision du formalisme thermodynamique permettant de modéliser le comportement de ces minéraux
- Brève n°39 - Des grains de pollen pour comprendre l’adaptation des arbres durant les dernières glaciations
- Brève n°40 - Déterminer la durée de la phase pré-éruptive d’un volcan grâce à l’analyse des roches volcaniques
- Brève N°23-01 - Expliquer la morphologie et le relief de la côte iranienne du Makran
- Brève_n°23-02
- Brève_n°23-03
- Brève_n°23-04
- Brève_n°23-05
- Brève_n°23-06
- Brève_n°23-07
- Brève_n°23-09
- Brève_n°23-10
- Brève_n°23-11
- Brève_n°23-13
- Brève_n°23-14
- Brève_n°23-15
- Brève_n°23-16
- Brève_n°23-17
- Brève_n°23-18
- Brève_n°23-19
- Brève_n°23-21
- Brève_n°23-22
- Brève_n°23-23
- Brève n°23-24
- Brève-n°23-25
- Brève_n°23-26
- Brève_n°23-28
- Brève_n°23-29
- Brève_n°23-30
- Brève_n°23-31
- Brève_n°23-32 - Plongée dans l’histoire tectonique fascinante des Caraïbes
- Brève_n°23-34
- Brève_n°23-35
- Brève_n°23-36 - Autopsie d’une dorsale ultra-lente : les processus d’exhumation disséqués
- Brève_n°23-37&38
- Brève_n°25-1
- Brève n°25-2
- Brève_n°25-3
- Brève_n°25-4
Chiffres clés (Mars 2025)
L'ISTeP comprend 131 membres dont :
Permanents (66)
- Professeurs : 17 (+2 PAST)
- Maîtres de conférence : 26
- Directeurs de recherche CNRS : 1
- Chargés de recherche CNRS : 1
- ITA : 19
Personnels non permanents (65)
- Collaborateurs bénévoles / émérites : 17
- Chaire de professeur junior : 1
- Enseignants-chercheurs contractuel : 2
- 1 MCF accueil en délégation
- ATER et Post-Docs : 9
- Doctorants : 32
- ITA-BIATSS : 3