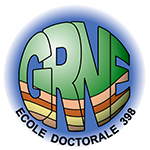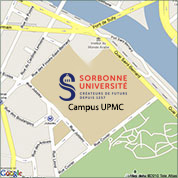EMVOLDIVA : un projet scientifique ambitieux qui mélange volcanologie et sciences sociales pour comprendre la cohabitation humain-volcan
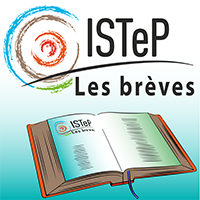
Pluies de cendres, coulées de lave, explosions, émissions de dioxyde de soufre… les risques sont nombreux lorsqu’on vit à proximité d’un volcan actif. Et pourtant, nombreux sont les habitants à s’être implantés aux côtés de ces éléments imprévisibles, malgré la menace et les catastrophes régulières. Cette cohabitation, parfois séculaire, a-t-elle pu permettre l’acquisition d’un savoir profond sur la dynamique éruptive ? Et de quelle manière l’histoire éruptive permet-elle de comprendre les trajectoires des sociétés ? Voilà les questions auxquelles vont s’intéresser les chercheurs du projet EMVOLDIVA, qui ouvre la voie à un nouveau champ d’étude : la volcanologie paléo-sociale.
Vivre avec un volcan, cela s’apprend. L’histoire des populations installées sur les îles volcaniques actives est ainsi souvent émaillée de catastrophes. Mais malgré les destructions et les pertes qui se sont succédé au fil des siècles, ces environnements n’ont pas été désertés pour autant et les habitants ont appris à reconnaitre et à anticiper les réveils de leurs volcans.
Une approche novatrice pour comprendre comment une population apprend à vivre aux côtés d’un volcan actif
C’est un savoir unique qu’ont ainsi accumulées ces sociétés régulièrement frappées par de violentes éruptions. Un savoir acquis au fil de siècles, voire de millénaires, d’observations du comportement des volcans, et qui a permis dans certains cas de mettre en œuvre des stratégies d’anticipation du risque volcanique très efficaces. Des connaissances qui pourraient permettre aux scientifiques de mieux comprendre l’histoire volcanique d’un lieu et le comportement éruptif de ces édifices. Autant de données qui permettent de mieux anticiper le risque volcanique de manière globale.
C’est en ce sens qu’a été proposé le projet EMVOLDIVA (Environmental Migrations and VOlcanic DIsasters in VAnuatu). Mené par Hélène Balcone-Boissard, chercheuse à l’Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP, Sorbonne Université), et Maëlle Calandra, chercheuse à l’unité de recherche migrations et société (URMIS), il réunit de nombreux partenaires issus de branches scientifiques diverses (volcanologie, anthropologie, archéologie, géographie) et d’institutions différentes. Une approche interdisciplinaire nécessaire à la compréhension de la façon dont une société apprend à vivre avec son volcan.
Le Manaro Voui est un volcan actif particulièrement dangereux dont les éruptions menacent régulièrement la population de l’île d’Ambae dans l’archipel du Vanuatu © Hélène Balcone-Boissard, projet EMVOLDIVA.
Ambae : 3 000 ans de vie sous la menace d’un volcan particulièrement dangereux
L’océan Pacifique, avec sa ceinture de feu, regorge d’îles où la menace volcanique est permanente. Parmi elles, l’île d’Ambae, située au centre-nord de l’archipel du Vanuatu, présente un intérêt particulier en termes de cohabitation humain-volcan. Les habitants de cette petite île vivent en effet à proximité d’un volcan particulièrement actif et dangereux, appelé le « Manaro Voui ». Lors de sa dernière éruption majeure, en 2017-2018, ce volcan a provoqué une grave crise, qui a poussé les autorités à évacuer de force, à deux reprises, l’ensemble de la population, soit plus de 10 800 personnes. Face au risque d’une nouvelle éruption, le gouvernement a également encouragé les habitants à s’installer définitivement sur l’île voisine de Maewo. Mais malgré le risque volcanique, cette migration a été difficile à accepter pour les habitants, fortement attachés à leur territoire, et dont les pratiques socio-culturelles sont étroitement liées à l’île d’Ambae et à l’histoire éruptive du volcan.
La crise de 2017-2018 révèle ainsi à quel point il est nécessaire, pour comprendre l’impact d’une telle catastrophe « naturelle » sur les habitants, de prendre en compte les interactions qui se sont forgées sur le long terme entre une société et son environnement. Car qu’en est-il du savoir local, accumulé au fil des générations ? Il faut en effet rappeler que les premiers habitants se sont installés à travers l’archipel il y a 3 000 ans. Cette présence humaine de longue date témoigne d’une relation particulière à l’environnement dans lequel les habitants ont développé des stratégies pour cohabiter avec leur volcan.
Évacuation forcée des habitants d’Ambae lors de l’éruption du Manaro Voui en 2018 © Paul Jones
EMVOLDIVA, un projet ambitieux qui ouvre la voie à la volcanologie paléo-sociale
L’île d’Ambae représente ainsi un cas d’étude particulièrement intéressant pour l’analyse des interactions sur le long terme entre une population et un environnement présentant un risque majeur. Il s’agit de l’objectif du projet EMVOLDIVA, qui a débuté en 2024. L’exploration de cette cohabitation entre humains et volcan nécessite donc de combiner Sciences Humaines et Sociales et Sciences de la Terre, dans une approche innovante et sans précédent. Le but de ce projet est d’aller au-delà de la simple étude chronostratigraphique permettant de caractériser l’histoire éruptive du Manaro Voui et son comportement volcanique, en y associant des études en Sciences humaines et sociales. Pour Hélène Balcone-Boissard et Maëlle Calandra, coordinatrices du projet, il s’agit ainsi véritablement de la définition d’un nouveau champ d’étude : la volcanologie paléo-sociale.
Ce projet, qui a été défini sur une durée de quatre ans et a obtenu un financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) s’articule autour de trois grands axes de recherche, tous interdisciplinaires. Le premier a comme objectif d’établir la chronologie détaillée de l’éruption de 2017-2018 via une étude de terrain, d’en définir la dynamique et les processus (signaux préliminaires, remontée de magma et dégazage) et d’évaluer les impacts sociaux de l’éruption via l’étude du déplacement des habitants et de ses effets. Le second axe de recherche vise à mieux comprendre l’histoire du peuplement de l’île d’Ambae au regard de l’activité du volcan sur les trois derniers millénaires. Il s’agit notamment d’établir si, au cours du temps, les éruptions ont provoqué des mouvements significatifs de la population, mais également d’estimer le temps de récurrence des éruptions et leur intensité. Enfin, le troisième axe est dédié à la formulation de recommandations en termes de politiques publiques pour la prévention du risque volcanique, en se basant sur les résultats des deux précédents axes. Afin de communiquer les résultats du projet EMVOLDIVA, un roman graphique sera par ailleurs produit par l’illustrateur Hippolyte.
L’analyse stratigraphique des dépôts volcaniques (ici ceux de l’éruption de 2017-2018) vont permettre de mieux contraindre l’histoire éruptive du Manaro Voui depuis le début du peuplement de l’île d’Ambae il y a 3 000 ans © Hélène Balcone-Boissard, projet EMVOLDIVA.
Mieux protéger les populations soumises aux risques volcaniques
L’ensemble de ces recherches impliqueront donc des scientifiques issus de nombreux domaines, mais également des partenaires locaux qui contribueront à l’acquisition des données.
Le projet bénéficie déjà d’un carnet de recherche accessible en ligne, qui sera régulièrement mis à jour afin de promouvoir et diffuser les travaux de ce programme scientifique innovant.
Les connaissances acquises au terme de ce projet pourront bien sûr s’appliquer à d’autres populations vivant à proximité d’un volcan actif, et elles sont nombreuses. À travers le double volet volcanologie et Sciences humaines et sociales, l’objectif final d’EMVOLDIVA est en effet de sensibiliser l’ensemble des pouvoirs publics concernés et de participer à la mise en place de stratégies de protection des sociétés vivant dans un environnement volcanique.
Texte rédigé par Morgane Gillard
Egalement dans la rubrique
- Brève n°2 - Des grains de pollen pour reconstruire l’histoire des mangroves
- Brève n° 6 - Dater les plissements tectoniques à l’aide des veines et des failles qui affectent les couches
- Brève n°33 - De la matière organique continentale enfouie au fond des océans !
- Brève n°34 - Les vers de terre ont un rôle essentiel dans la minéralisation du carbone organique
- Breve n°35-Le volcanisme de Mayotte ne serait pas lié à un point chaud
- Brève n°36 - Première image interne du nouveau volcan sous-marin, Fani Maoré, au large de Mayotte
- Brève n°37 - Volcanisme et tectonique découverts le long de l’archipel des Comores entre l’Afrique et Madagascar : Une limite de plaque en développement.
- Brève-n°38 - Au cœur de la structure des plagioclases : révision du formalisme thermodynamique permettant de modéliser le comportement de ces minéraux
- Brève n°39 - Des grains de pollen pour comprendre l’adaptation des arbres durant les dernières glaciations
- Brève n°40 - Déterminer la durée de la phase pré-éruptive d’un volcan grâce à l’analyse des roches volcaniques
- Brève N°23-01 - Expliquer la morphologie et le relief de la côte iranienne du Makran
- Brève_n°23-02
- Brève_n°23-03
- Brève_n°23-04
- Brève_n°23-05
- Brève_n°23-06
- Brève_n°23-07
- Brève_n°23-09
- Brève_n°23-10
- Brève_n°23-11
- Brève_n°23-13
- Brève_n°23-14
- Brève_n°23-15
- Brève_n°23-16
- Brève_n°23-17
- Brève_n°23-18
- Brève_n°23-19
- Brève_n°23-21
- Brève_n°23-22
- Brève_n°23-23
- Brève n°23-24
- Brève-n°23-25
- Brève_n°23-26
- Brève_n°23-28
- Brève_n°23-29
- Brève_n°23-30
- Brève_n°23-31
- Brève_n°23-32 - Plongée dans l’histoire tectonique fascinante des Caraïbes
- Brève_n°23-34
- Brève_n°23-35
- Brève_n°23-36 - Autopsie d’une dorsale ultra-lente : les processus d’exhumation disséqués
- Brève_n°25-1
- Brève n°25-2
- Brève_n°25-3
- Brève_n°25-4
- Brève_n°25-07
Chiffres clés (Mars 2025)
L'ISTeP comprend 131 membres dont :
Permanents (66)
- Professeurs : 17 (+2 PAST)
- Maîtres de conférence : 26
- Directeurs de recherche CNRS : 1
- Chargés de recherche CNRS : 1
- ITA : 19
Personnels non permanents (65)
- Collaborateurs bénévoles / émérites : 17
- Chaire de professeur junior : 1
- Enseignants-chercheurs contractuel : 2
- 1 MCF accueil en délégation
- ATER et Post-Docs : 9
- Doctorants : 32
- ITA-BIATSS : 3