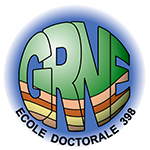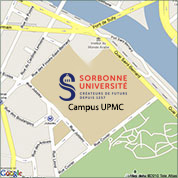Projet STORY
Risques et sociétés dans le bassin de la Roya (Alpes-Maritimes, France) : analyse pluridisciplinaire et multi-temporelle, des versants à la mer
Objectifs
Les Alpes du Sud connaissent des événements torrentiels, comme l’illustrent les inondations qui ont touché le département du Var en juin 2010 ou les Alpes Maritimes en novembre 1994. L’évolution des risques hydrologiques, plus particulièrement torrentiels, est au cœur des préoccupations des acteurs et des gestionnaires du territoire, dans un contexte de densification du bâti dans les zones à risques et d’un accroissement probable de la fréquence et de l’intensité des phénomènes hydro-météorologiques extrêmes en raison du réchauffement de la Méditerranée.
Le 2 octobre 2020 la tempête « Alex » a provoqué un épisode météorologique méditerranéen exceptionnel : plus de 500 mm sont tombés en quelques heures par endroits, provoquant notamment plus d’un milliard d’euros de dégâts. Les conséquences psychologiques et sociales, pour l’instant moins visibles, seront aussi très importantes. Après cette crise, la campagne océanographique SEALEX (financée par l’INSU) a été réalisée du 1er au 9 novembre 2020. Elle vise, d’une part, à caractériser la tempête « Alex » à partir de son enregistrement dans les dépôts sédimentaires offshore et, d’autre part, à analyser la réponse des événements météorologiques dans la zone à travers les temps. Les longues carottes offrent la possibilité d’identifier la fréquence naturelle d’événements similaires à « Alex ».
7 / 7
En plus d’une analyse transdisciplinaire de la catastrophe d’octobre 2020, le projet se distinguera d’une étude « classique » de science des risques en intégrant différentes échelles temporelles : l’histoire des risques et de leur perception dans la vallée à partir d’archives historiques, l’évolution des risques et de leur gestion en croisant l’étude des archives sédimentaires terrestres avec celle des vestiges archéologiques, la récurrence des crues extrêmes, en lien avec les changements climatiques.
Cette acquisition de données représente une opportunité rare pour une recherche scientifique originale sur les catastrophes, en croisant un examen critique de la crise d’octobre 2020 avec une étude de l’évolution holocène des risques dans la vallée de la Roya avec une volonté permanente de développer, avec les acteurs locaux, un ensemble de recommandations pour la reconstruction de leur territoire visant à réduire les impacts des futurs événements extrêmes.
Grâce à une équipe de recherche transdisciplinaire, STORY permettra l’exploitation d’une énorme quantité de données collectées par d’autres projets et campagnes pour caractériser, modéliser et finalement élaborer des recommandations pour prévenir d’autres catastrophes en collaboration avec les populations locales.
Localisation des relevés bathymétriques et des carottages effectués en novembre 2020 durant la campagne SEALEX (financées par l’INSU)
Dans le but de contribuer à une reconstruction des territoires de la vallée plus adaptée aux risques d’origine naturelle, un ensemble de recommandations sera élaboré avec les acteurs locaux, notamment à partir des connaissances que le projet STORY permettra d’acquérir. Cette démarche s’appuiera sur des modélisations intégrant l’étude des processus naturels d’octobre 2020 et de la vulnérabilité des territoires impactés ainsi que l’analyse de la gestion de la crise et de ses conséquences économiques, sociales et écologiques.
Le projet STORY ambitionne de montrer qu’une méthode fondée sur la transdisciplinarité et sur les sciences participatives peut apporter des réponses efficaces aux besoins immédiats et à long terme des populations touchées par les catastrophes naturelles.
En savoir plus sur le projet STORY => ici
Egalement dans la rubrique
Chiffres clés (Mars 2025)
L'ISTeP comprend 131 membres dont :
Permanents (66)
- Professeurs : 17 (+2 PAST)
- Maîtres de conférence : 26
- Directeurs de recherche CNRS : 1
- Chargés de recherche CNRS : 1
- ITA : 19
Personnels non permanents (65)
- Collaborateurs bénévoles / émérites : 17
- Chaire de professeur junior : 1
- Enseignants-chercheurs contractuel : 2
- 1 MCF accueil en délégation
- ATER et Post-Docs : 9
- Doctorants : 32
- ITA-BIATSS : 3